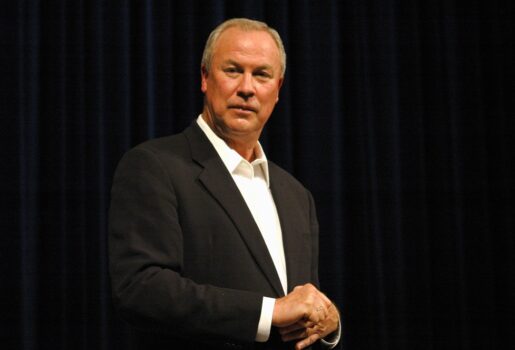« Travailler avec Bob Wilson, c’était accepter de ralentir, aimer observer, s’émerveiller, rechercher à déconstruire pour que chaque respiration, chaque pas, chaque silence trouve sa nécessité.
Au-delà de l’œuvre, je veux saluer l’homme. Curieux, exigeant, drôle, génial ! Il avait gardé, malgré le poids de la légende, quelque chose de l’enfance dans son émerveillement. Il nous répétait, inlassablement, que la forme est le contenu. Et chez lui, cette phrase n’était pas un paradoxe : c’était une ligne de vie. »
Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d’Automne à Paris,
Le théâtre orphelin d’un maître du regard et du silence
Le monde du spectacle vivant vient de perdre l’une de ses figures les plus singulières et novatrices. Le metteur en scène américain Robert Wilson s’est éteint en juillet dernier, laissant derrière lui une trace indélébile dans l’histoire du théâtre et de l’opéra contemporain. Sa disparition marque la fin d’une ère, tant Wilson a su révolutionner l’art scénique par un langage visuel d’une rigueur et d’une poésie inégalées.
Un créateur entre lumière, espace et temps
Né en 1941 au Texas, Robert Wilson a très tôt bousculé les conventions du spectacle vivant. Fondateur du légendaire Byrd Hoffman School of Byrds, une communauté d’artistes vivant et répétant dans un entrepôt désaffecté de trois étages avec une salle de spectacle au rez-de-chaussée dans le Lower Manhattan, il a imposé un style inimitable : une esthétique de la lenteur, un travail précis sur les lumières et les ombres, des silhouettes hiératiques évoluant dans des espaces géométriques, presque oniriques. Ses créations brouillent les frontières entre théâtre, danse, opéra et arts visuels, invitant le public à une expérience sensorielle rare, où chaque geste, chaque silence, chaque lumière, acquiert la densité d’un poème.
Une rencontre féconde avec l’univers de Richard Wagner
Parmi les multiples territoires artistiques explorés par Robert Wilson, le répertoire wagnérien occupe une place de choix. Sa fascination pour l’œuvre de Richard Wagner, compositeur phare du XIXᵉ siècle, s’est traduite par des mises en scène qui ont profondément marqué le paysage lyrique.
L’approche de Wilson face à l’univers wagnérien est immédiatement reconnaissable : il s’éloigne de la monumentalité traditionnelle pour privilégier l’abstraction, l’épuration et la symbolique visuelle. Dans ses lectures du « Ring », notamment, il transforme la Tétralogie en une fresque moderne, baignée de lumières bleutées, où les personnages semblent flotter dans un espace-temps suspendu. Les mythes germaniques et la quête de l’infini trouvent chez lui une dimension contemplative, presque méditative, loin des excès grandiloquents.
Parsifal, un sommet du dialogue wagnérien
Sa mise en scène de Parsifal, créé sur la scène du Hamburgische Staatsoper en mars 1991 avec Kurt Moll en Amfortas, demeure l’un des jalons de son parcours. Wilson y propose un rituel scénique fait de silences, d’apparitions fantomatiques, d’une gestuelle codifiée à l’extrême. Wilson utilise des décors épurés, des couleurs primaires, et une lumière sculptée pour créer une atmosphère presque sacrée. L’espace scénique, un anneau lumineux descendant du ciel, entourant un bloc de glace puis une flamme, est un tableau mouvant, où chaque geste est chorégraphié avec précision.Les questions métaphysiques et spirituelles soulevées par Wagner y résonnent avec une intensité nouvelle, servies par une esthétique où la lumière sculpte le récit autant que la musique. Cette vision a renouvelé l’écoute et la perception de l’œuvre, ouvrant de nouveaux horizons pour le public comme pour les interprètes.
Lohengrin, une production qui a changé le Met
Quant à la mise en scène du Lohengrin de Wagner au Metropolitan Opera de New York en 1998 reçu dans une tempête de huées, provoquant une controverse considérable divisant public et critiques. Mais, comme le rappelle le New York Times (1), cette production a changé la politique artistique du Met qui a commencé à s’ouvrir à des tendances moins conservatrices et traditionnelles.
Un legs immense, un appel à la contemplation
Avec Bob, nous travaillons toujours de la même manière. Le travail sur le texte ne l’intéresse pas. Le sens non plus, ou alors en le saisissant autrement. Par le son, les variations sonores, le rythme. Il ne dit guère que “lentement”, “plus vif” ! Il va directement à la conséquence du sens, à l’état dans lequel il nous met. Ne lui importent que ces états-là.
Dès Orlando, j’avais compris qu’il fallait se laisser inviter dans l’univers abstrait de Bob, tout en y pénétrant physiquement comme dans une forêt dense à explorer, jour après jour, pour trouver son chemin. La solution pour réussir alors le va-et-vient constant entre mémoire des déplacements et mémoire des mots ? Répéter inlassablement.
Isabelle Huppert, actrice
Bob Wilson laisse derrière lui une œuvre magistrale, où chaque production est un territoire d’émotions inédites. Le théâtre et l’opéra pleurent la disparition d’un magicien du plateau, mais son art, lui, demeure vivant, appelant chacun et chacune à réapprendre la patience, l’écoute, et l’émerveillement face à la beauté de la lenteur.
(1) Zachary Woolfe, How a Production of Wagner’s ‘Lohengrin’ Changed the Met Opera, NYTimes du 15 février 2023.