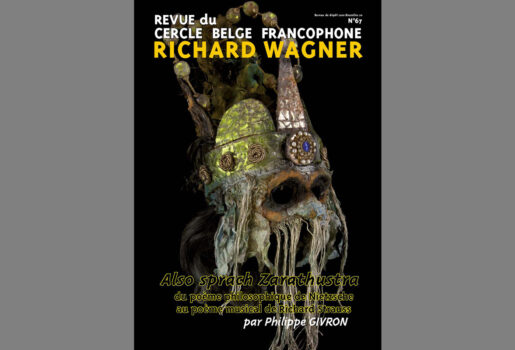Notre prochaine revue :
Also sprach Zarathustra, du poème philosophique de Nietzsche au poème musical de Richard Strauss
Par Philippe Givron, administrateur du Cercle Wagner
Introduction
Also sprach Zarathustra 1, un titre qui résonne et annonce deux œuvres majeures au crépuscule du siècle romantique. Distantes d’à peine une dizaine d’années, deux créations tellement proches et pourtant si différentes ! Peut-on déceler les échos de la pensée fulgurante de Nietzsche dans les élans du somptueux poème symphonique de Richard Strauss ? Si la musique donne certes à penser, la pensée se prête-t-elle à une mise en musique ?
Les rencontres explicites entre ces deux formes d’expression sont plutôt rares, pensons au Candide de Bernstein d’après le conte philosophique de Voltaire ou encore au Socrate de Satie. Mais le prophète persan Zarathoustra semble curieusement avoir frappé l’imaginaire des compositeurs. Les mélomanes l’auront déjà côtoyé à travers le Zoroastre de Jean-Philippe Rameau ou le personnage de Sarastro dans La Flûte enchantée. Et très singulièrement,
le Zarathustra de Nietzsche a inspiré pas moins de trois compositeurs célèbres en l’espace de quelques années ! Richard Strauss (1896), Gustave Mahler pour un mouvement de sa troisième symphonie (1893 -1896), et Frederick Delius, dans A Mass of Life (1898-1905). Le compositeur allemand est cependant le seul à relever le défi de faire parler son œuvre … sans faire appel à la voix !
Après avoir rappelé quelques éléments significatifs de la vie des deux auteurs, nous explorerons les parentés liant le Zarathustra littéraire avec son hommage straussien sous forme de Tondichtung, un poème symphonique. Les articles approfondis traitant de ce sujet sont plutôt rares et privilégient l’analyse musicale. Notre approche met l’accent sur l’ancrage philosophique et sa traduction trahison musicale, dans un aller-retour entre les niveaux conceptuel et émotionnel.
Philippe Givron
Septembre 2025
Un résumé de l’article
Ce document propose une étude approfondie et détaillée de l’œuvre « Also sprach Zarathustra », en confrontant le poème philosophique de Friedrich Nietzsche à la transcription musicale réalisée par Richard Strauss. Il s’agit d’une revue du Cercle belge francophone Richard Wagner qui explore les liens entre philosophie et musique à travers ces deux créations majeures de la fin du XIXe siècle.
Introduction et contexte biographique
L’ouvrage débute par une introduction mettant en lumière la rareté des œuvres musicales directement inspirées de textes philosophiques, avec « Also sprach Zarathustra » comme exemple remarquable. Nietzsche (1844-1900), philosophe novateur et controversé, est présenté à travers son parcours intellectuel et personnel marqué par une pensée critique de la morale traditionnelle, du christianisme et de la métaphysique. Son œuvre majeure « Ainsi parla Zarathoustra » est décrite comme un conte philosophique poétique, porteur de concepts tels que le Surhumain, la Volonté de puissance et l’Éternel Retour, écrite dans un style prophétique et métaphorique .
Richard Strauss (1864-1949), compositeur allemand, est présenté comme un enfant prodige élevé dans un environnement musical privilégié, influencé par son père et par des mentors tels qu’Alexander Ritter. Sa carrière de compositeur et chef d’orchestre est marquée par une évolution stylistique, passant d’une forte influence wagnérienne à une recherche personnelle, notamment dans le genre du poème symphonique. Sa découverte progressive de la pensée nietzschéenne, notamment à travers ses lectures et ses amitiés, joue un rôle déterminant dans sa création musicale, notamment dans « Also sprach Zarathustra » composée entre 1894 et 1896 .
L’œuvre philosophique de Nietzsche
Le Zarathoustra de Nietzsche est un livre complexe, divisé en quatre parties comportant 81 chapitres, mêlant récits, discours et poèmes. Il met en scène le prophète Zarathoustra, porte-parole du Surhumain, figure d’un homme qui se dépasse en rejetant les valeurs morales traditionnelles et en affirmant la vie avec ses contradictions. Nietzsche critique violemment la religion chrétienne, la science et la morale dominante, proposant une transvaluation des valeurs et une affirmation joyeuse de l’existence (amor fati). Le concept d’Éternel Retour y est central, invitant à vivre chaque instant comme s’il devait se répéter éternellement .
Le poème symphonique de Richard Strauss
Strauss transpose librement ces idées en musique dans un poème symphonique en un seul mouvement, utilisant un orchestre massif et une forme très libre. L’œuvre est structurée en neuf sections musicales portant des titres empruntés à certains chapitres du livre de Nietzsche, mais choisis et ordonnés librement. Strauss emploie une dizaine de leitmotivs, motifs musicaux associés à des idées ou émotions telles que la Nature, le Désir, la Foi, la Religion, la Science, le Dégoût, la Danse, la Passion et l’Idéal. Ces leitmotivs ont une double signification, conceptuelle et affective, reflétant la pensée nietzschéenne qui mêle philosophie et vécu émotionnel .
Analyse des principales sections musicales et philosophiques
Le Prologue : Le Surhumain et l’ode au soleil levant
L’introduction musicale célèbre la grandeur d’une Nature éternelle et puissante, symbolisée par le lever du soleil, avec un motif simple et solennel en do majeur. Le Surhumain, figure centrale du Zarathoustra, est évoqué comme un idéal d’homme créateur de ses propres valeurs, au-delà des morales traditionnelles. Strauss ne lui associe pas de leitmotiv spécifique, mais le parcours musical illustre ses luttes et dépassements .
Des arrière-mondes : Les illusions métaphysiques
Cette section critique la religion chrétienne, qualifiée d’illusion et d’hallucination collective, source de souffrance et de renoncement à la vie. Nietzsche dénonce l’institution et ses valeurs, tandis que Strauss illustre cette critique par le leitmotiv de l’Effroi, symbolisant la peur existentielle face à la Nature sacrée, suivi des thèmes de la Foi et de la Religion, présentés de manière séduisante mais ironique .
Du grand désir : La Volonté de puissance
La musique exprime le désir ardent de dépassement, incarné par un leitmotiv intense, qui balaye les illusions religieuses. La Volonté de puissance, concept clé de Nietzsche, est associée à l’Impulsion vitale, énergie interne qui anime la vie et pousse à la créativité et à la conquête de soi. Strauss traduit cette lutte par un développement musical énergique et contrasté .
Des joies et des passions : Le renversement de la morale
Nietzsche, à travers Zarathoustra, propose une transvaluation des valeurs morales, rejetant l’altruisme, l’égalité et l’ascétisme traditionnels au profit d’une affirmation individuelle et d’une nouvelle noblesse fondée sur la force et la création de soi. La musique illustre cette exaltation des passions, mais aussi la résistance du dégoût et des épreuves, par des leitmotivs puissants et contrastés .
Le chant du tombeau : La lutte héroïque
Cette section évoque la nostalgie de la jeunesse et la lutte constante contre les ennemis et les obstacles. Le leitmotiv de la Nature et celui du Désir réapparaissent, symbolisant la volonté invulnérable, malgré les épreuves. Strauss se projette ici dans une figure héroïque de combat et de dépassement, en écho à la vie personnelle de Nietzsche et à sa propre carrière .
De la Science : L’illusion de la vérité
Nietzsche critique la science comme une spécialisation stérile, incapable d’offrir un sens véritable à la vie. Strauss crée un leitmotiv de la Science froid et déshumanisé, utilisant une série dodécaphonique et une fugue, symbolisant la complexité sans aboutissement. La musique oppose ce thème à celui du Désir et de la Danse, illustrant la nécessité de dépasser cette illusion .
Le convalescent : L’Éternel Retour
La révélation de l’Éternel Retour, idée d’un cycle infini de la vie, provoque un choc violent chez Zarathoustra, suivi d’une convalescence et d’une renaissance symbolisée par un chant du coq. Strauss traduit cette étape par une montée dramatique et une atmosphère oscillant entre découragement et éveil, préparant la célébration finale .
Le chant de la danse : La Vie dionysiaque
Cette section célèbre la Vie dans son intensité, son union métaphysique et sensuelle avec Zarathoustra. La danse, associée à Dionysos, incarne la joie, la légèreté et la libération des pesanteurs intellectuelles. Strauss utilise des rythmes de valse et des mélodies charmantes pour exprimer cette célébration amoureuse et passionnée .
Le chant du noctambule : L’amor fati
La dernière partie met en musique le poème de Zarathoustra sur le chant nocturne, symbole de l’acceptation joyeuse et totale de la vie (amor fati). Les douze coups de minuit rythment ce chant qui mêle douleur et joie, souffrance et éternité. Strauss conclut par un apaisement musical, mais avec une fin ouverte et dissonante, traduisant l’impossibilité de résoudre pleinement la tension entre l’homme et la Nature .
Conclusion : La clef des émotions philosophiques
L’étude conclut que l’œuvre de Strauss n’est pas une simple illustration musicale de la philosophie de Nietzsche, mais une libre transposition émotionnelle et poétique. La musique exprime la dynamique affective suscitée par la lecture du Zarathoustra, traduisant les passions, luttes et espérances du philosophe-poète. La complémentarité des langages philosophique et musical est soulignée, chacun parlant à des niveaux différents, mais se fertilisant mutuellement pour enrichir la compréhension et l’expérience de ces œuvres majeures .
Ainsi, cette revue offre une analyse rigoureuse et nuancée, mettant en lumière la richesse des interactions entre pensée et musique à travers « Also sprach Zarathustra », et propose une lecture renouvelée de ces créations emblématiques du tournant du XXe siècle.